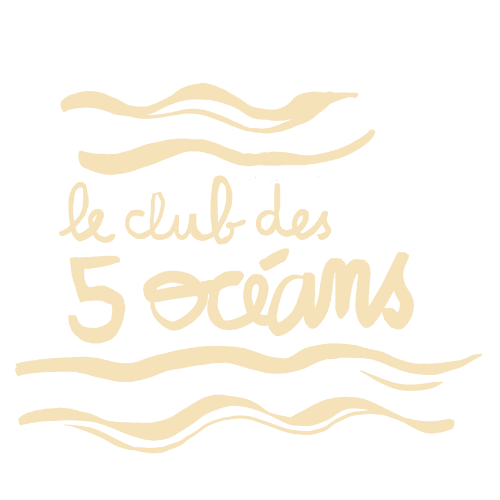PlanktoSpace : comprendre la vie marine depuis l’espace
Le Club des 5 Océans embarque dans un programme scientifique mondial
Chaque litre d’eau de mer contient entre 10 et 100 milliards de micro-organismes. Invisibles à l’œil nu, ils forment pourtant la base de tous les écosystèmes marins. Ce sont des virus, bactéries, algues microscopiques, larves, protozoaires et petits animaux dérivants : en un mot, le plancton.
Ces milliards d’êtres minuscules sont responsables de près de la moitié de l’oxygène produit sur Terre, participent à la régulation du carbone atmosphérique, et constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire océanique. Sans eux, la vie marine telle que nous la connaissons n’existerait pas.
Pourtant, malgré leur importance capitale, la biodiversité planctonique reste très mal connue, notamment à grande échelle. Comprendre comment cette microfaune réagit aux changements environnementaux — température, acidification, pollution — est aujourd’hui un enjeu majeur pour la science et pour la planète.
Le projet PlanktoSpace
C’est tout l’objectif du programme PlanktoSpace (2025-2028) : relier ce que nous voyons depuis l’espace, grâce aux satellites d’observation, à ce qui vit réellement dans l’eau.
Les satellites de la NASA (PACE) et de l’ESA (Sentinel-2 et Sentinel-3) mesurent en continu la couleur des océans. Ces variations de teinte — du bleu profond au vert turquoise — sont influencées par la concentration de micro-organismes, par leurs pigments, et par les particules présentes dans l’eau.
Mais pour interpréter correctement ces signaux, il faut disposer de mesures in situ (sur le terrain) prises au même moment et au même endroit que les images satellites.
C’est là qu’intervient PlanktoSpace : un vaste effort collaboratif visant à constituer un jeu de données mondial pour entraîner des algorithmes d’intelligence artificielle capables de déduire la biodiversité planctonique directement à partir des observations spatiales.
Une flotte citoyenne au service de la science
Pour collecter ces données, le programme mise sur une flotte d’une vingtaine de bateaux volontaires sillonnant toutes les mers du globe. Des voiliers, souvent associatifs ou scientifiques, qui se trouvent au bon endroit au bon moment.
Ces “navires d’opportunité” réalisent des prélèvements d’eau de mer selon un protocole rigoureux :
entre 10h30 et 13h30 (au moment du passage des satellites),
à plus de 5 milles des côtes,
par ciel dégagé,
et en suivant un procédé standardisé pour garantir la comparabilité des données.
Chaque échantillon est ensuite filtré, analysé et documenté :
une partie est destinée à des analyses génétiques (métabarcoding ADN), qui permettent d’identifier les espèces présentes ;
l’autre est observée au microscope grâce au Curiosity microscope, un appareil portable conçu pour visualiser la diversité du plancton à bord.
Ces observations sont transmises aux laboratoires partenaires, puis croisées avec les images satellites pour affiner les modèles d’interprétation.
Un réseau scientifique international
Le programme PlanktoSpace réunit un consortium international de haut niveau :
Plymouth Marine Laboratory (UK) – spécialiste en télédétection marine et observation de la Terre ;
Sorbonne Université / Station Biologique de Roscoff (France) – référence mondiale en écologie planctonique et analyses génétiques ;
University of Maine (USA) – experte en optique océanique et colorimétrie satellitaire ;
Université du Littoral Côte d’Opale (France) – pour l’analyse et la modélisation des données ;
et le réseau Seatizens for Plankton Planet (S4P2) – qui coordonne la participation des équipages citoyens et le déploiement des kits de prélèvements.
Le projet est soutenu par la NASA et l’ESA, et s’inscrit dans le prolongement des programmes de recherche planétaire comme Tara Oceans, qui ont profondément transformé notre vision de la biodiversité océanique.
Le rôle du Club des 5 Océans
À bord de notre catamaran MaJoCo, nous aurons la chance de faire partie de cette aventure scientifique.
Notre mission consistera à réaliser des stations d’échantillonnage tout au long de notre tour du monde, selon les protocoles PlanktoSpace.
Nous serons équipés d’un kit de prélèvement complet : filet à plancton, le système de filtration « Lamprey », le “Curiosity”, un microscope portable d’une conception absolument géniale, des membranes pour les analyses ADN, des tubes d’échantillonnage, et des manuels d’identification du plancton.
Chaque station permettra de prélever, filtrer, observer et documenter un échantillon d’eau de mer dans des conditions précises.
Ces données seront ensuite intégrées à la base mondiale du programme, contribuant ainsi à l’entraînement d’algorithmes d’apprentissage automatique capables d’associer couleur océanique et biodiversité.
Mais notre rôle ne s’arrête pas là : à travers ce partenariat, nous pourrons partager cette expérience scientifique avec les écoles, les jeunes et le grand public, et montrer concrètement comment la science participative contribue à la recherche fondamentale.
Observer la biodiversité depuis l’espace : un défi pour demain
L’un des grands espoirs de PlanktoSpace est de permettre, à terme, une surveillance continue et globale de la biodiversité marine.
Grâce à la combinaison des données satellites et des mesures réalisées par les navigateurs, les chercheurs pourront suivre en quasi temps réel :
les dynamiques saisonnières du plancton,
les effets des changements climatiques sur la composition biologique des océans,
et les effets des perturbations anthropiques (pollution, eutrophisation, réchauffement).
Ces avancées ouvriront la voie à une nouvelle génération d’indicateurs écologiques, capables de décrire la santé des océans à partir de l’espace.
Pourquoi ce partenariat compte pour nous
Pour le Club des 5 Océans, ce projet incarne parfaitement notre mission : explorer, sensibiliser, et partager les connaissances sur l’environnement marin.
Participer à PlanktoSpace, c’est relier la science de pointe et la navigation citoyenne, tout en contribuant à une meilleure compréhension de l’océan.
Chaque échantillon que nous collecterons, chaque observation que nous transmettrons, aidera la recherche à mieux comprendre le fonctionnement de notre planète bleue.
Et c’est aussi un moyen de montrer, à travers l’aventure du MaJoCo, que chacun peut participer à la science, à son échelle.
« Changement de couleur global de l’océan : un nouveau paramètre à surveiller »
Des travaux récents montrent que la fonte des glaces polaires modifie non seulement l’étendue des banquises, mais aussi la couleur de l’eau de mer. Lorsque la banquise fond, la lumière du soleil pénètre différemment dans l’eau, et la composition spectrale du rayonnement absorbé change.
En zone de glace, une part importante de la lumière est réfléchie par la surface blanche ou par la glace elle-même, ce qui autorise un spectre large de longueurs d’onde à pénétrer. Lorsque la glace disparaît, l’eau libre absorbe davantage les longueurs d'onde rouge et verte, laissant le bleu dominer. Selon l’étude de Monika Soja‑Woźniak et Jef Huisman (2025), la disparition de la glace est associée à un spectre lumineux plus “bleu-dominant” dans les couches de surface.
Pourquoi est-ce important ?
Ce changement de couleur modifie les conditions de lumière dont bénéficient le phytoplancton et les algues, qui sont adaptées à des spectres donnés. Chez certaines espèces polaires autrefois sous glace, la nouvelle lumière plus “purement bleue” devient moins favorable.
Ces modifications peuvent entraîner un changement de composition des communautés planctoniques : par exemple, les diatomées adaptées à la lumière diffuse sous glace peuvent être remplacées par des espèces mieux adaptées à un éclairage bleu clair.
Enfin, cela implique un effet en cascade sur les chaînes alimentaires et sur les processus de fixation du carbone marin : si les espèces planctoniques changent, leur capacité à absorber du CO₂ ou à alimenter les écosystèmes marins peut évoluer.
Pour le programme PlanktoSpace, ce phénomène renforce l’intérêt d’étudier la couleur de l’océan comme indicateur de la biodiversité. Non seulement parce que la couleur perçue par satellite reflète la présence de plancton, mais aussi parce que la nature même de cette couleur évolue, sous l’effet du changement climatique, de la fonte des glaces ou de la turbidité. Les algorithmes doivent donc intégrer non seulement la concentration de plancton, mais aussi les changements de spectre lumineux liés à la fonte des glaces ou à d’autres perturbations.
Cela renforce la dimension “scientifique de pointe” du partenariat : comprendre, calibrer et suivre ces changements globaux oblige à collecter des données in situ précises et variées — ce que rendent possibles des partenaires comme MaJoCo.